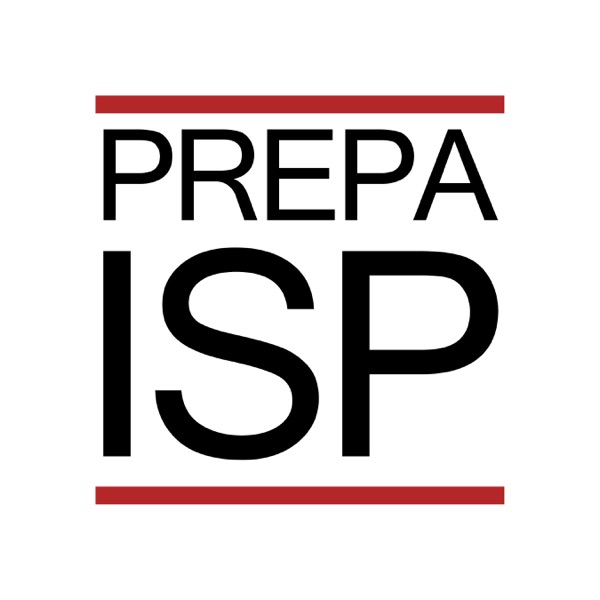Le procès des attentats de Charlie Hebdo
Les podcasts de l'ISP - En podcast av Prépa ISP - Onsdagar

Kategorier:
La lutte contre le terrorisme est l'un des défis majeurs de la communauté internationale. Elle représente aujourd’hui la menace la plus importante contre la sécurité intérieure et les démocraties. L’année 2015 a été une année particulièrement noire pour la France, qui a été est touchée et frappée par la commission de plusieurs attentats terroristes dont la violence est sans précédent. Cette année 2015 a en effet débuté par l'attaque des locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier où 11 personnes étaient abattues par deux individus armés, par le meurtre d'une policière municipale à Montrouge le lendemain, et ensuite le 9 janvier, par la prise d'otages dans le supermarché Hypercacher de la porte de Vincennes et l'assaut au sein de l'imprimerie à St Dammartin en Goelle. Ces attentats faisaient au total 17 morts et plusieurs blessés. La France a été profondément marquée par ces faits et cette tension dramatique qui se sont déroulés sur 2 journées. Ces évènements ont eu un écho mondial et ont donné lieu à des cérémonies et rassemblement tant des citoyens que des chefs d’Etats afin de rappeler haut et fort les valeurs de nos démocraties. Plus de cinq ans et demi après, 14 personnes ont été jugées au cours d'un procès qui s'est tenu pendant 54 jours du 2 septembre au 16 décembre 2020 à Paris devant la cour d’assises spécialement composée. Onze d’entre elles figuraient dans le box des accusés. Trois autres étaient absentes et toujours recherchées. A bien des égards ce procès semble historique et unique. Non seulement en raison de la violence des faits, inédite, de son fort impact médiatique, sa durée, des moyens déployés, mais également en raison des débats sociétaux qu'il relance. Ce procès soulève également bien des questions : en effet, quel peut être le sens d'un procès où les principaux accusés sont absents ; le procès était -il limité à faire œuvre de réparation et de vérité auprès des victimes ou peut-on finalement dire qu'il aura une portée historique ? Le rôle véritable de la justice est -il le même dans les procès terroristes que celui des procès criminels de droit commun ? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec Stéphanie AUSBART, magistrat, qui était en 2015 magistrat coordonnateur de formation pénale au sein de l'Ecole nationale de la Magistrature à Paris, et qui était notamment chargée du pôle anti-terroriste concernant la formation des magistrats. Stéphanie AUSBART est également enseignante de droit pénal et de procédure pénale au sein de la Prépa ISP.