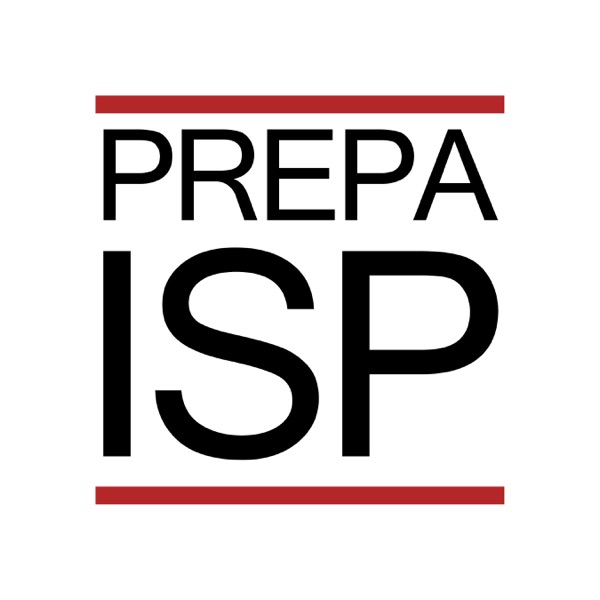10 questions sur la fin de vie
Les podcasts de l'ISP - En podcast av Prépa ISP - Onsdagar

Kategorier:
Au sens courant du terme, la fin de vie désigne la fin d’une existence. Elle renvoie à une question fondamentale sur laquelle s’est construite l’existence humaine : la mort. L’Homme est né pour mourir. De l’existentialisme de Sartre à la résurrection du Christ, la mort est centrale dans l’œuvre humaine. Au sens juridique, selon le code de la santé publique, la fin de vie désigne les moments qui précèdent le décès d’une personne "en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’elle qu’en soit la cause". Les progrès de la médecine peuvent conduire à des situations de survie jugées indignes par certains. C’est pourquoi la fin de vie entre dans le champ des débats bioéthiques depuis les années 1970. Le sujet fait régulièrement l’actualité sociétale et juridique. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu, le 13 septembre 2022, un avis sur la fin de vie. Cet avis ouvre la voie à une "aide active à mourir" strictement encadrée. L’instance, qui s’était auto-saisie du sujet en juin 2021, considère "qu’il existe une voie pour une application éthique de l’aide active à mourir, à certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger". Pour faire le point sur l’état du droit relatif à la fin de vie mais aussi ses perspectives, nous recevons Grégory Portais, professeur de droit public au sein de la prépa ISP.